Mort de la fillette de Granby : Le système l'a abandonnée selon le rapport de la coroner
La police est intervenue 24 fois à son domicile entre 2012 et le jour de son décès.
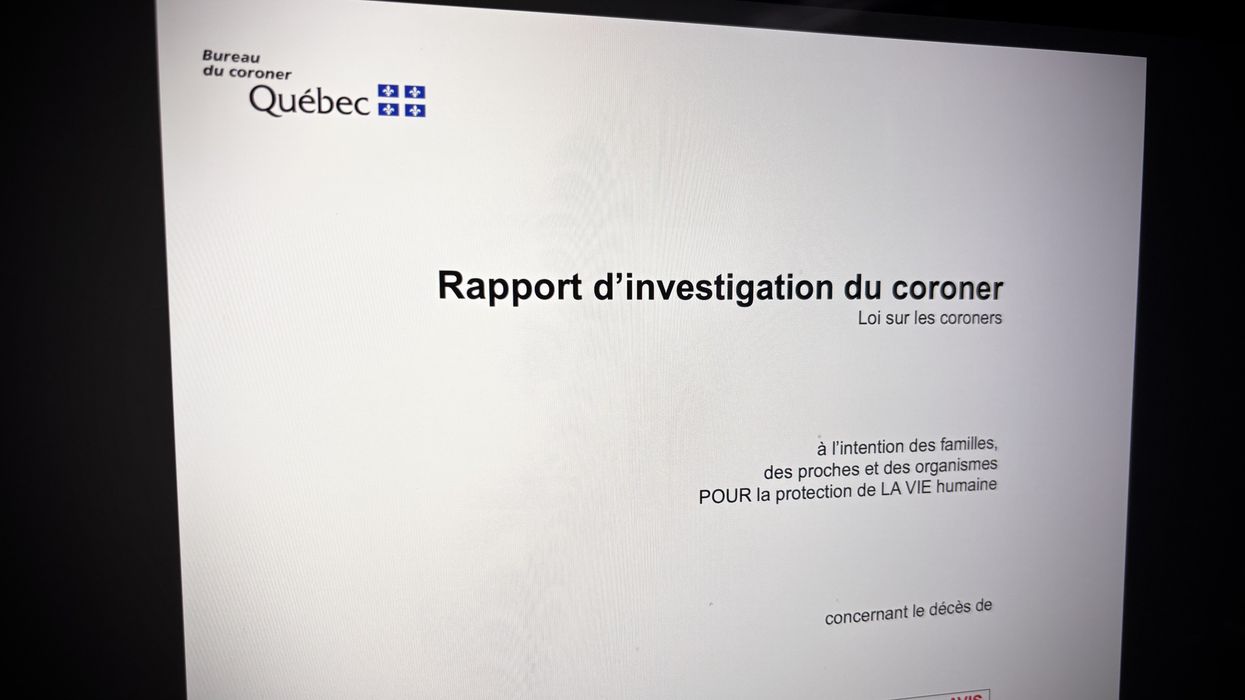
Un système défectueux qui travaille en silo a mené à la mort de la fillette de Granby, selon le rapport de la coroner.
Dans son rapport d'investigation, la coroner Me Géhane Kamel ne mâche pas ses mots à l'endroit du « système » qui n'a pas su protéger la fillette de Granby, décédée tragiquement en avril 2019. Selon elle, toutes les instances censées la protéger l'ont laissée tomber. On fait le point.
À lire également : Accident mortel sur l'autoroute 30 : Un GoFundMe pour soutenir une mère endeuillée lancé
La mort de la petite fille de sept ans avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Pourtant, « plusieurs signes avant-coureurs laissaient présager cette tragédie », écrit d'entrée de jeu la coroner dans son analyse rendue publique ce mercredi 3 septembre.
En début d'analyse, Me Kamel va jusqu'à rédiger une mise en garde, en raison d'extraits du rapport « insoutenables ».
Si elle y déplore notamment l’absence de coordination entre la police, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), le milieu scolaire et le réseau de la santé, elle fait un retour détaillé sur les dernières heures menant au décès de la fillette.
Ces mêmes détails avaient été révélés lors du procès du père et de la belle-mère de l'enfant de sept ans, à l'automne 2021, choquant le Québec.
Elle mangeait dans les poubelles
Dès septembre 2018, le personnel scolaire avait noté que l’enfant était visiblement négligée : souvent affamée, vêtue de façon inadéquate, avec vêtements souillés, des blessures, absente à répétition. Il avait même remarqué que la fillette de Granby mangeait dans les poubelles.
« Tous étaient conscients que [la fillette] mangeait tout ce qui se trouvait à sa portée, connaissait l’horaire des poubelles et volait des lunchs à l’école. Elle disait souvent ne pas avoir déjeuné le matin », précise la coroner.
Une journée, l’enfant de sept ans confie à son enseignante qu’elle reçoit des douches froides et chaudes en guise de punition, et qu’elle est enfermée dans sa chambre. Un signalement a été fait à la DPJ, mais l'information n'aurait jamais abouti.
Des pratiques policières douteuses
En novembre 2018, elle arrive à l’école avec des blessures et accuse sa belle-mère. Le signalement est retenu, mais l’entrevue menée par la police, et qui durera huit minutes, se déroule dans un poste, sans climat « sécurisant ».
L’enfant se tait, après avoir « nécessairement reçu des instructions de son père », affirmant que « ce qui se passe à la maison doit rester à la maison ».
« Cette entrevue, en elle-même, soulève de nombreux questionnements fondamentaux. D’abord, est-ce réellement la manière la plus judicieuse de sécuriser un enfant que de le rencontrer dans un poste de police, un lieu souvent perçu comme intimidant, voire menaçant, pour les plus jeunes? » écrit Me Géhane Kamel.
« Lorsqu’un enfant de sept ans exprime clairement une réticence à parler, ne devrait-on pas faire preuve d’une prudence accrue, d’autant plus que l’historique familial est déjà bien documenté, se questionne la coroner. Maintenir [la fillette] avec sa belle-mère le temps d’être vue par les enquêteurs, n’était-ce pas là un lourd fardeau à lui faire porter? Faut-il s’étonner qu’elle n’ait pas voulu parler? »
Il faut dire qu'entre 2012 et le jour de sa mort, décrit noir sur blanc comme étant un homicide, la police est intervenue pas moins de 24 fois au domicile de son père, où elle habitait.
« Ces informations à elles seules n’auraient-elles pas dû indiquer un drapeau rouge? », souligne-t-on.
Le 30 mai 2018, après trois remises à la cour, la juge a ordonné que l’enfant demeure sous la garde de son père, et ce, malgré des signalements répétés de violence conjugale et de violence directe à l’égard de l’enfant.
Un constat accablant
Dans ses conclusions, la coroner est claire : « L’absence de cohésion entre les intervenants a compromis la capacité du système à offrir un accompagnement global et centré sur l’enfant. Les indicateurs préoccupants étaient nombreux et concordants. Les mécanismes de protection n’ont pas permis d’assurer une réponse suffisamment concertée afin d’éviter son décès ».
Dans son rapport, Me Géhane Kamel formule 12 recommandations, en plus d’appuyer celles de la Commission d’enquête sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, présidée durant la pandémie par Régine Laurent.
Dans le dossier de la fillette de Granby, la coroner ne blâme aucune institution ni le travail de la DPJ. Cette dernière ne peut « être seule à porter la responsabilité du bien-être des enfants ni à être blâmée lorsque survient un échec ».
« Je suis convaincue que personne n’a agi de mauvaise foi. Chacun œuvrait dans son propre silo, oubliant malheureusement l’essentiel : [la fillette], conclut-elle. Ce drame ne relève pas uniquement du réseau hospitalier, de la DPJ ou du milieu scolaire. Il engage la responsabilité de tous les acteurs : CLSC, protection de la jeunesse, éducation, justice, santé et, j’ose le dire, à chaque membre de cette société, qu’il soit parent ou simple citoyen. »
Le père de la fillette de Granby a été condamné en janvier 2022 à quatre ans de prison pour séquestration. Sa conjointe, reconnue coupable de meurtre non prémédité, a écopé de la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 13 ans.
- Fillette de 3 ans disparue en juin 2025 : Le procès de la mère débutera la semaine prochaine - Narcity ›
- Tout ce qu'on sait sur la disparition de la petite fillette de 3 ans disparue - Narcity ›
- La fillette de 3 ans aperçue vivante en Ontario le jour de sa disparition selon la SQ - Narcity ›
- Fillette de 3 ans retrouvée : La SQ demande à la population d'arrêter de partager sa photo - Narcity ›
- Disparition d'une fillette : La SQ demande à la population d'attendre avant de s'en mêler - Narcity ›
- Disparition d'une fillette de 3 ans : La SQ recherche une fermière - Narcity ›
- La mère de la fillette abandonnée cet été est reconnue non criminellement responsable - Narcity ›
- La mère de la fillette de 3 ans retrouvée en juin restera à l’Institut psychiatrique Pinel - Narcity ›